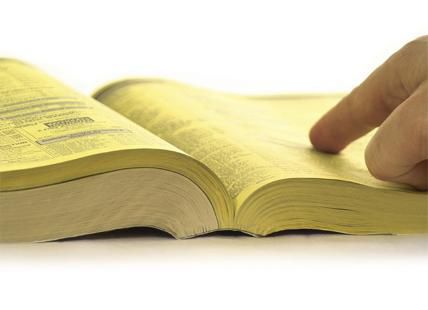Puisque l'on disserte sur l'enseignement de la lecture, j'en profite pour vous confier quelques réflexions personnelles. Quand on regarde dans le rétroviseur, on s'aperçoit que les pb avérés de l'enseignement de la lecture sont apparus officiellement vers la fin des années 50, certainement parce que de plus en plus d'enfants n'arrivaient pas à apprendre à lire. Lors, des tas de gens se sont penchés sur le problème pour avancer des explications plus ou moins fumeuses et pour proposer telle ou telle méthode.
Ce qui est frappant, c'est que près d'un demi-siècle plus tard, on en est au même point, alors qu'il est loisible de penser que, pendant toute cette période, des études sérieuses auraient pu déboucher sur des résultats irréfutables et la remédiation nécessaire (ce mot n'existe pas dans le dico, mais bon, chez les enseignants, il fait fureur. C'est d'autant plus rigolo que tout le monde ne lui accorde pas la même signification. D'aucuns pensent au "remède", d'autres à la "re-médiation" ; mais bon, le temps de trouver la parenthèse de fermeture et je suis à vous).
Pourquoi cette situation? J'ai bien l'impression qu'on ne peut toujours pas généraliser sur l'explication du processus qui fait qu'on apprend à lire. De plus, pour les diverses chapelles, "savoir lire" ne correspond pas forcément à une définition commune, d'où les difficultés pour s'entendre.
Malgré tout, une évaluation est nécessaire si l'on veut rester crédible, et c'est là que le bât blesse (d'où la méthode annonée "Léo et les bâts" ; non, là, j'déconne...). Et c'est là qu'on remarque à nouveau (enfin, en ce qui me concerne) que le milieu scolaire est complétement shizophrène, car l'enseignant lui-même est juge et partie, du moins dans le meilleur des cas, celui où il décide d'évaluer les résultats de son travail. Lorsque les premières évaluations en CE2 eurent lieu, il y a une quinzaine d'années, quel émoi dans le marigot scolaire dont la plupart des membres se sont drapés dans un "Quoi ? Me faire ça à moi, c'est une méthode scandaleuse, je refuse" (ou alors je triche lors de la passassion, démolissant de fait le protocole prévu).
Vécu de l'intérieur, on s'aperçoit que les enseignants sont paradoxalement des êtres profondément conservateurs. Et les différentes grèves et autres refus de toute réforme (proposée à gauche comme à droite) ne sont pas le signe d'un milieu rebelle, mais celui d'un groupe social qui ne veut surtout pas que les choses changent, par paresse, par peur de l'inconnu, par pusillanimité.
On aime bien se faire passer pour progressiste, mais faut pas déconner, quand même ; les avantages acquis, on y tient ! Et la culture de l'évaluation, qui existe partout ailleurs (et qui devrait exister encore plus chez des fonctionnjaires rémunérés sur les deniers publics) engendre une aversion viscérale, de peur d'être jugé à l'aune des résultats de ses élèves.
Et pourtant, à défaut de connaître précisément la façon dont on apprend à lire, on pourrait de manière empirique classifier les "méthodes" en fonction des résultats obtenus... Cela permettrait, entre autre, de donner des points de départ, des pistes aux étudiants des IUFM.
Mais non : il suffit de parcourir les listes de diffusion d'enseignants dans lesquelles chacun s'accroche à sa méthode comme un morpion, voire réfute la validité d'une évaluation nationale, en proposant sa propre grille !
Une chose est sûre : ce qui se passe actuellement en matière de lecture, et plus généralement d'éducation, se fait au détriment des élèves les moins "favorisés" (je n'aime pas cette expression, comme s'il existait un être chargé de favoriser ou non les pauvres bipèdes que nous sommes). En clair, l'ascenceur social représenté jadis par l'école a du plomb dans l'aile et il faudrait d'urgence faire appel à Roux et Combalusier. Les statistiques sont formels à cet égard. Mais là aussi, les enseignants ont horreur des stats et donc, retour à la case départ.
Michel Tournon